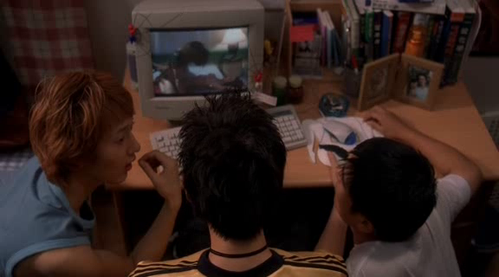Open City, Lee Sang-gi, 2008

Eté 2008. A l’heure de la France sarkozyste, de notre société franchouillarde de comptoir aux relents xénophobes latents à la Pernaut/Bardot et de notre système quasi-ultra-sécuritaire...
A l’heure où la parano nous enferme à double tour, que la crise des « subprimes » sévit, que les rangs du FN grossissent et que les entreprises dégraissent…
Oui à cette heure-ci, où les corps gisent au quatre coin du monde, que la famine est présente sur les cinq continents et que The Wire, meilleure série de tous les temps connait sa ponctuation (elle résume, à elle seule le monde tel qu’il tourne, tel que nous tournons « time after time »). A l’heure où…
La peur du moment était toute trouvée. Elle était là à m’envahir alors que les reportages de TFOne et MSixe s’immisçaient en moi de façons insidieuses. J’avais besoin de parler, de me confier et d’expier mes pensées vigilantes. Sans Congo ne voulait plus entendre parler de moi depuis un cadeau que je lui avais offert. Joy Means Sick était sur répondeur à teufer au Pacha Club sur ses semelles compensées. J’étais esseulé, le cinéma pour seul confort. Je partais à la recherche d’un film me permettant d’esquiver et ainsi me protéger des pickpockets ! Le mal du moment. Ils étaient partout sur la capitale et sa banlieue. On les disait également en province mais n’ayant jamais quitté l’Île-de-France de ma vie, je ne pouvais affirmer cette information. Les principaux fautifs au désordre ? Les Roms ! 500 000 individus d’après mes sources (Brice H. et Eric B.). 500 000 chances de plus de se faire dépouiller de ses biens en allant travailler ou promener. Mon sang se glaçait. Mes poils s’irisaient. Et les doigts tapotaient sur mon clavier pour enfin s’arrêter sur… Open City ! Il était de 2007 et surfe donc sur la vague de l’actualité française. Certes, le film est sud-coréen mais qu’importe ! Au fond de moi, je savais. Je savais qu’il jouerait son rôle, celui de l’apprentissage. Qui plus est, son titre était des plus évocateurs : « Ville ouverte » (pas Rome, hein ?), ouverte aux délinquants à la petite semaine. Oh ben mince alors ! En plus, il y avait Son Ye-jin et excusez du peu mais Son Ye-jin est super bonne. The Classic, A Moment to Remember, April Snow,… autant de films qui par sa présence m’ont fait tourner la tête. Autant de films qui m’ont permis de lui offrir quelques-unes de mes branlettes. Le topo est là, ça fait : Séoul, ville ouverte voit s’affronter plusieurs gangs de pickpockets. La police compte bien en finir avec eux à l’image de l’inspecteur Cho (Kim Myeong-min) qui ne recule devant rien, encore moins devant sa mère (Kim Hae-sook) qui vient de sortir de prison. Il traque bientôt une délicieuse jeune femme (la p’tite Ye-jin) qui tatoue des tatouages… stylé.

Et puis je débande. Est-ce que son intro, ses quelques scènes d’actions et le jeu juste de Kim Hae-sook sauvent-ils Open City du naufrage ? « Not really » pour faire le british pédant… Pourtant, Open City commençait bien. Cette séquence d’affrontement entre policiers et malfrats… elle m’a fait saliver. Ensuite le film n’a rien de bien surprenant et d’original (comme 95% de la production annuelle, me direz-vous et je ne vous écoute pas). Peu importe. Si ce n’est de donner la part belle au métier de pickpocket, plutôt rare au cinéma, vous en conviendrez. C’est ce bon point qui me l’a fait choisir. Je voulais voir des pickpockets œuvrés avec brio. Je voulais apprendre leurs combines pour me défendre dans la rue. Mais au lieu de nous les montrer en action, de développer les techniques de « fauche », d’offrir des instants captivants digne de ce nom à ces détrousseurs, le réalisateur se perd dans les clichés du thriller à romance. Si cela est bien fait, pourquoi pas. Surtout si l’intrigue tient la route. Problème. Le film s’enlise dans une intrigue principale sans intérêt et qui ennuie le plus souvent. Et sachant qu’il dure plus de deux heures, les choses sont dures à encaisser. On prend conscience que le film est miné par des séquences pas franchement nécessaires au bon déroulement de l’histoire. De plus, la grande majorité du temps les personnages parlent pour ne rien dire. N’est pas Quentin Tarantino qui veut. Les répliques tournent à vide. Est-ce que l’essence même des dialogues n’est pas faite de manière à faire avancer le récit ? Pas d’après la définition qu’en a Lee Sang-gi (rappelons qu’il est également le scénariste, une casquette dont il aurait pu se passer au vu du résultat). Un faux-rythme s’installe alors. Et toute forme de suspense s’évapore à mesure que le film avance, parce mal exploité à l’image de cette équipe de pickpockets.

Que fait Lee Sang-gi de cette équipe qui donnait à voir ? Il ne l’exploite jamais. Il n’approfondi aucun de ces personnages secondaires. Pas une fois, il ne les fait « briller » à l’écran alors qu’il avait tout pour le faire. Non ce qu’il préfère c’est le rapport de force d’une mère et d’un fils que tout oppose. Tant pis pour le métier de pickpocket, tant pis pour les seconds couteaux et tant mieux parce que le sujet semble intéressant. Imaginez le fils, policier qui retrouve sa mère, pickpocket, et vice versa. Elle est libérée de prison depuis peu. Et vas-y qu’elle l’aime toujours. C’est bien normal puisque c’est son fiston. Mais vas-y que lui, il n’a pas pardonné les écarts de sa mère avec la loi. L’amorce donne à voir. Résultat des courses ? Le réalisateur plombe son récit avec une grosse louche mélodramatique qui fatigue. Il nous vomit un trop plein de bons et mauvais sentiments dégoulinants. Il force ce trait lacrymal dans une surenchère… maman, ce que c’est lourd. Voilà l’une des sous-intrigues pleines de pathos qui tourne au ridicule. L’antithèse que forment le fils et la mère aurait pu offrir un tableau pathétique de la situation, couple sujet/opposant. Mais le cinéaste s’y prend comme un tâcheron qui aplanirait le plâtre avec la taloche alors qu’un vrai maçon userait avec doigté de sa truelle. Ce qui en devient pathétique, c’est cette relation justement. Il passe à côté de son sujet. A la limite, il aurait traité l’ensemble avec un second degré, il aurait réussi son pari. Mais c’est au premier degré que l’auteur n’est pas capable de laisser vivre ses personnages à l’écran. C’est avec ce même premier degré qu’il n’est pas capable d’avoir une forme de retenue dans cette façon de communique la dimension psychologique de ses personnages. Lee Sang-gi torche l’environnement qu’il dépeint (les pickpockets) et fait le choix, non dénuer d’intérêt de s’arrêter sur les retrouvailles d’une mère et d’un fils. Malheureusement, il ne sait l’exploiter. Quand est-ce que les cinéastes comprendront qu’il n’y a pas besoin de musique pour communiquer un sentiment ? Qu’il n’y a pas besoin de bla-bla superflu ? Qu’il n’y a pas de peur à avoir du silence ? Qu’on n’a pas besoin de faire poser ses acteurs pour laisser transparaitre des états-d’âmes ? Le constat est celui-ci : le scénario n’a rien à raconter.

Particulièrement parce que le scénario est d’un bateau pathétique. Arrêtons-nous sur la romance. L’intrigue principale. Ce pour quoi le film existe, nous raconter ce jeu du gendarme et du voleur, entre un flic « beau gosse » et une voleuse sexy. Voir ce flic et cette voleuse se tourner autour alors qu’il pourrait lui passer les bracelets dès le début. Désolé (je ne le suis même pas) ! Ce n’est pas crédible. On nous justifie donc tout le film sur cette pseudo-romance de pacotille ? La crédibilité de l’entreprise en prend un coup. On veut nous raconter un thriller avec un couple à l’écran dont devrait découler une aura érotique mais d’emblée, l’histoire est faussée parce que basée sur du vent. Au menu : opposition des fonctions, manipulations, jeu de l’interdit. Autant se refaire un Basic Instinct parce qu’ici, l’ensemble reste incroyablement chaste et froid. Lee Sang-gi voulait nous raconter une histoire d’amour interdite. Il fallait pour se faire inventer une histoire crédible si l’on traite son sujet de façon sérieuse. Il y a des choses au cinéma qui ne passent pas. Et généralement, les facilités scénaristiques en font partie. D’ailleurs, cette remise en cause scénaristique me pousse à remettre en cause le duo d’acteurs principaux. Ils souffrent de camper des personnages qui ne sont pas captivants et qui sont vus et revus. On les croirait échappés d’une autre production similaire, c’est bien dommage. Et puis sans être méchant, Kim Myeong-min est une huitre. Ce faciès… Sa prestation est réellement décevante voire risible. Quant à Son Ye-jin, il est vrai qu’elle est jolie et bien plus encore. Elle porte merveilleusement le rouge, le blanc ou bien le noir mais après ? On assiste plus à un défilé de couturier que d’un film avec une intrigue. Quant au dénouement d’Open City ? Je préfère m’arrêter ici. J’éviterai ainsi de vous parler de ce énième flash-back de fin de film qui ne sert strictement à rien avec ses révélations qui n’apportent rien et un twist… no comment. J’ai envie de pleurer, un peu comme Kim Myeong-min dans le générique final, tiens. Prenez le SPOILE en pleine tronche ! Ouais, Kim Myeong-min chiale comme une gamine. De toute façon, c’est devenu monnaie courante dans ce genre de prod’ bien fade. Bon allez, concluons.

En 1/ (parce que je retranscris une déception) Le personnage interprété par Kim Hae-sook aurait mérité un tout autre traitement. Un personnage (actrice) qui aurait mérité un film à lui (elle) tout(e) seul(e), intéressant dramatiquement parlant. Par malheur, ce n’est pas elle qui est au cœur du récit mais son fils de flic (ou flic de fils ?), lisse comme Kim Ah-joong après ses opérations de chirurgie esthétique et bidon comme son enquête qui n’en est pas vraiment une. Une investigation à l’image des rivalités entre pickpockets qui vaut « peanuts ».
En 2/ (parce que bon quand même quoi) Aussi étonnant que cela puisse paraitre, la mise en scène d’Open City n’est pas à remettre en cause. Elle n’est pas à blâmer puisque l’auteur parvient à offrir une réalisation qui a du style (toute proportion gardée parce qu’il y a beaucoup d’effets – de style justement – dont il aurait pu se passer). Elle fonctionne plutôt bien dans les scènes d’actions que certains trouveront peu nombreuse notamment à côté de la profusion de parlote poussive, encore et toujours. Alors si vous n’êtes pas allergique à l’aspect clipesque, ça devrait aller. On regrettera tout de même qu’il ne la filme pas cette « ville ouverte ». Il enferme ses personnages dans un cadre qui ne fait jamais écho au titre du film. Du coup, ça manque d’ampleur mais ce n’est pas fâcheux. On notera le respect du cahier des charges : il y a une scène de pluie !
Et en 3/ (parce qu’il faut finir) Open City de Lee Sang-gi vaut juste pour ses quelques scènes d’action, rien d’autre. Il ne vaut même pas pour les robes saillantes et sexy de Son Ye-jin… enfin… un peu quand même.
En bonus : le frangin de JMS nous réalise une cace-dédi pour la donzelle Son Ye-jin :
Bon ! L’urgence de la situation veut qu’un constat s’impose. Open City ne m’apprendra rien sur les Roms et les pickpockets, la loose. Pourtant, cette déroute ne m’empêchera pas de continuer mon apprentissage de la vie et de ses dangers. Coûte que coûte, je persévérerai sur cette voie et je compte sur vous pour m’y aider ! Coréenement votre…
PS : Autre que les battes de base-ball, couteaux, matraque télescopique, barre de fer,… des outils de choix ont été répertoriés : lame de rasoir, cloueur autonome, raquette de tennis et bâton de tatouage. Sur ce, je vous bise la fesse gauche.
I.D.